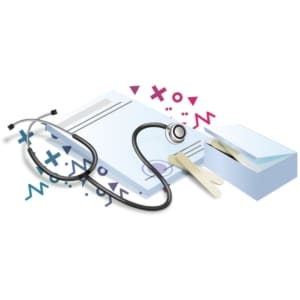En 2022, 5,6 millions de Français ont été traités pour une maladie cardio-neurovasculaire, dont 530 000 en phase aiguë.
Ces maladies cardio-neurovasculaires ou leurs complications causent 140 000 décès chaque année.
Avec le vieillissement de la population, les nombreux facteurs psychosociaux et environnementaux, souvent cumulatifs, et les pathologies à risques cardio-vasculaires comme le diabète ou l’hypertension artérielle, le nombre de personnes sous anticoagulants ne cesse d’augmenter d’année en année.
On estime son nombre à plus de 3 millions.
Et, parce qu’ils sont très efficaces, les anticoagulants que prennent vos patients sont aussi susceptibles d’induire des effets indésirables et de mettre en péril leur vie.
C’est notamment le cas des antithrombotiques, qui font partie des médicaments les plus souvent en cause dans les hospitalisations liées à un effet indésirable médicamenteux.
Il est donc primordial que vos patients respectent scrupuleusement les prescriptions, le suivi et les consignes.
Et, c’est aussi vrai pour vous qui intervenez au domicile de ces patients sous anticoagulants : en cas de problème, votre responsabilité peut être engagée.
Il est crucial que vous maitrisiez les risques que peuvent entraîner ces traitements, afin d’apporter un suivi de qualité et sécurisé à vos patients, mais aussi pour vous protéger.
Alors, refaisons un point sur les anticoagulants, et votre rôle dans l’administration et le suivi de ces patients à risque, et déjà fragilisés par la maladie.
Comprendre les anticoagulants et leurs indications :
Définition et mécanismes d’action :
L’anticoagulant empêche la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins, en agissant sur différents facteurs de la coagulation en fonction de la classe à laquelle il appartient.
On distingue les anticoagulants oraux et les anticoagulants injectables.
Les anticoagulants oraux :
Il existe deux types d’anticoagulants oraux :
- Les anticoagulants oraux directs (AOD) : inhibiteurs directs du facteur Xa (Rivaroxaban, Apixaban), et inhibiteurs directs de la thrombine (anti-IIa), comme le Dabigatran.
- Les antivitamines K (AVK) dont les dérivés coumariniques (Warfarine) et les dérivés de l’indanedione (Fluindione : Previscan). En France, 70% des prescriptions d’AVK concernent le Previscan.
Les anticoagulants injectables :
On y retrouve les :
- Héparines non fractionnées (HNF).
- Héparines à bas poids moléculaire (HBPM).
- Antithrombotiques (Fondaparinux).
Indications principales :
La principale indication du traitement par anticoagulant est la fibrillation auriculaire, suivie de la maladie thromboembolique.
Les anticoagulants peuvent être prescrits pour différentes raisons, parmi lesquelles :
- Le traitement et la prévention des thromboses veineuses profondes et des embolies pulmonaires.
- La prévention des AVC et des embolies systémiques en cas de fibrillation auriculaire.
- Les pathologies à haut risque thrombotique comme le syndrome des anticorps antiphospholipides (thrombophilie acquise), ou après un infarctus du myocarde (IDM).
- L’immobilisation temporaire de patients : intervention chirurgicale comme la PTH ou la PTG, fracture d’un membre inférieur…
À noter que les AVK sont déconseillées en cas d’IR modérée et contre-indiquées en cas d’IR sévère.
| AVK : | AOD : |
| Thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire. Cardiopathie emboligène. Complications de l’infarctus du myocarde et de l’insuffisance cardiaque. Porteur de valve cardiaque mécanique. Relais de l’héparine en cas d’anticoagulation prolongée. | Traitement curatif des thromboses veineuses profondes, des embolies pulmonaires, prévention de leurs récidives… Traitement préventif des maladies thromboemboliques. |
Classification des anticoagulants :
| Types d’anticoagulant : | Exemples : | Surveillance : |
| Héparines : HNF et HBPM | Enoxaparine Fondaparinux | TCA (Temps de Céphaline Activée) pour l’HNF. Dosage de l’anti-Xa pour les HBPM prolongées. |
| AVK : | Fluindione Warfarine | INR (International Normalized Ratio). La valeur d’équilibre à atteindre est appelée « cible ». Elle varie en fonction de l’indication du traitement. |
| AOD : | Apixaban Rivaroxaban | Pas de suivi spécifique = Homogénéité de l’effet, pas d’adaptation du dosage. Contrôle de la fonction rénale (clairance, créatine), suivi clinique. |
Le rôle de l’infirmier dans la prise en charge des patients sous anticoagulants :
Surveillance clinique et prévention des complications :
Nous l’avons vu, les anticoagulants ne sont pas des médicaments à prendre à la légère, compte du risque hémorragique qu’ils peuvent induire.
Le suivi médical et les contrôles sanguins prescrits doivent être rigoureusement respectés.

En tant qu’infirmier libéral, votre rôle auprès des patients sous anticoagulant est crucial.
Non seulement vous êtes le lien entre votre patient et son médecin, notamment dans la transmission des résultats des examens et l’adaptation éventuelle des doses, mais vous êtes au cœur de la prise en charge quotidienne.
Votre rôle est de :
- Évaluer toutes les situations à risque : pratique d’un sport de contact, risque de chutes, autoconsommation de médicaments en vente libre (notamment l’aspirine, les AINS, les plantes, huiles essentielles et compléments alimentaires aux propriétés fluidifiantes) …
- Dépister le risque hémorragique : épistaxis, gingivorragie, hématurie, rectorragie, apparition rapide d’ecchymoses ou d’hématomes …
- Détecter les autres complications thrombotiques dès leur apparition : douleur au mollet, œdème unilatéral, dyspnée soudaine…
- Contrôler l’état clinique de votre patient : tension artérielle, fréquence cardiaque, saturation en oxygène…
- Réaliser les injections conformément à la prescription, en alternant les sites pour éviter ou minimiser les irritations, les nodules et les hématomes au point d’injection.
- Contrôler les prises médicamenteuses : respect des horaires et des consignes.
Enfin, la collaboration avec le médecin référent est essentielle à l’équilibre du traitement, à la stabilisation de la pathologie traitée, à la prévention des complications telles que l’ulcère gastrique, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, les varices œsophagiennes…, mais aussi à la prévention des complications liées à une mauvaise prise de l’anticoagulant, que ce soit par sous-dosage ou par surdosage.
En France, on estime à 17 000 le nombre d’hospitalisations annuelles évitables causées par un surdosage en AVK, et l’on considère que 60 % des erreurs médicamenteuses surviennent lors de l’administration du traitement.
Gestion des situations à risque et complications :
Éducation thérapeutique et sensibilisation du patient :
L’éducation thérapeutique de votre patient consiste à le sensibiliser sur :
- La maladie et ses risques.
- Son traitement, son but, les effets indésirables, les risques, et comment y faire face.
- L’importance du respect des consignes et du suivi médical.
- La conduite à tenir en cas d’oubli d’une prise : le déculpabiliser pour qu’il ne cache pas l’information, et pour éviter des investigations cliniques inutiles qui pourraient expliquer un changement dans les résultats.
- La conduite à tenir en cas de symptômes d’alerte.
- Les gestes à adopter au quotidien pour se prémunir des blessures : brossage doux des dents, évictions des sports de contact…
- Les interactions alimentaires : aliments riches en vitamine K, par exemple.
- Les dangers d’une automédication : notamment les médicaments en vente libre, interférant avec les anticoagulants (aspirine, AINS, plantes, huiles essentielles et compléments alimentaires…), et les interactions médicamenteuses.
Pensez à informer le patient des éventuelles modifications de traitement, et invitez-le à tenir un journal et à consigner les symptômes, pour l’impliquer dans sa prise en charge, mais aussi pour ne pas passer à côté d’un élément important.
Adaptation des soins infirmiers :
Certaines situations exigent que vous vous adaptiez.
Il s’agit notamment :
- D’une intervention chirurgicale à venir pour votre patient. Dans ce cas, vous faites le lien avec le médecin et l’anesthésiste pour obtenir une conduite à tenir en préopératoire et en post-opératoire.
- D’adapter la technique et le matériel à votre patient : utilisation de matériel atraumatique, prudence en cas d’injections intramusculaires…
- D’éduquer vos patients les plus autonomes et désireux de se prendre en charge : gestion des traitements, tenue du carnet de suivi, exécution des injections, utilisation du dispositif d’autosurveillance de l’INR …
À noter que le dispositif d’automesure de l’INR fonctionne de la même manière que celui qui permet de contrôler les glycémies capillaires.
Surveillance biologique et suivi médical :
Lorsque le traitement est instauré, le contrôle par analyses sanguines est rapproché.
En général, il est effectué une à 2 fois par semaine jusqu’à ce que la cible soit atteinte.
Il est ensuite plus espacé, généralement à intervalle d’un mois.
En revanche, un contrôle sera effectué à chaque adaptation de la posologie, et ce jusqu’au retour à l’équilibre.
À noter qu’avant la mise en place d’un traitement par anticoagulant, on contrôle les fonctions rénale et hépatique puis, régulièrement en cours de traitement.
Bilan de coagulation et suivi des AVK :
L’efficacité des traitements par AVK se fait par l’analyse de l’INR (International Normalized Ratio).
En règle générale, la cible thérapeutique de l’INR se situe entre 2 et 3, et idéalement à 2,5. C’est le cas d’un traitement par AVK instauré après un infarctus du myocarde, et pour la majorité des pathologies que vous rencontrez au domicile.
La cible de l’INR peut aussi être comprise entre 3 et 4.5 -et idéalement à 3.7- chez les patients porteurs d’une valve cardiaque artificielle.
Sans traitement, l’INR est de 1.
Plus l’INR est élevé, plus le sang met de temps à coaguler.
Le risque hémorragique est considéré comme réel lorsque l’INR atteint 5.
À noter que l’ajustement de la posologie se fait impérativement en concertation avec le médecin prescripteur.
Particularités des AOD :
Il n’existe pas de test de routine pour contrôler l’efficacité des AOD.
Votre rôle dans la prise en charge de ces patients est essentiellement basé sur la surveillance clinique de l’état général de votre patient et des signes évocateurs d’une complication.
En revanche, le suivi de la fonction rénale est nécessaire pour éviter l’accumulation du médicament.
Vous veillez aussi à la gestion des interactions qu’il peut y avoir avec certains antibiotiques et antifongiques.
Suivi des héparines (HNF et HBPM) :
L’évaluation du TCA est indiquée en cas de traitement par héparines non fractionnées.
Le dosage anti-Xa est réalisé en cas de traitement prolongé (> 10 jours) pour éviter un surdosage.
La surveillance des plaquettes est également nécessaire pour prévenir une thrombopénie induite par l’héparine (TIH).
Conduite à tenir en cas d’hémorragie :
En cas d’hémorragie, il est impératif d’évaluer la gravité du saignement et de réagir en conséquence.
Les antidotes et agents d’inversion disponibles sont :
- La vitamine K1 pour les AVK.
- Le sulfate de protamine : 1 unité de protamine neutralise 1 unité d’héparine.
- L’agent de réversion idarucizumab pour le Dabigatran.
- L’andexanet alfa pour le Rivaroxaban et l’Apixaban.
- Les concentrés de prothrombine (PCC) pour les urgences graves.
Risque thrombotique en cas d’oubli ou d’arrêt du traitement :
Lorsque vous prenez en charge un patient sous anticoagulant, insistez bien sur l’importance qu’a la régularité du traitement.
Veillez à obtenir un protocole préopératoire (par exemple : un protocole de relai par héparine en préopératoire), et évaluez le risque avec le médecin en cas d’intervention chirurgicale.
Enfin, il est important que votre patient ait en permanence sur lui un document mentionnant qu’il prend un traitement par anticoagulant.
En cas d’accident, les secours et les médecins qui le prendront en charge, agiront en conséquence.
Facturation et cotation des soins infirmiers liés aux anticoagulants :
| Types de soins : | Cotations : |
| Injection sous-cutanée | Ami (x) 1 Ami (x) 1,5 |
| Prélèvement par ponction veineuse | Ami (x) 1,5 |
| Surveillance et observation d’un patient lors de la mise en œuvre d’un traitement ou lors de la modification de celui-ci, avec établissement d’une fiche de surveillance, avec un maximum de quinze passages. | Ami (x) 1 |
| Accompagnement à domicile de la prise médicamenteuse, lors de la mise en œuvre ou de la modification d’un traitement ou au cours d’une situation clinique susceptible de remettre en question la stratégie thérapeutique, pour un patient non dépendant, polymédiqué et présentant des critères de fragilité identifiés par le médecin, avec un retour écrit au médecin. | AMI 5,1 : séance initiale Ami 4,6 : 2ème et 3ème séance |
Les règles de cumul habituelles s’appliquent :
- Cumul à taux plein du prélèvement sanguin avec le BSI
- Cumul à 50% de l’injection sous-cutanée avec le BSI
- Dégressivité des cotations : 100% pour le premier acte, 50% pour le deuxième, et pas de cotation application pour les suivants qui deviennent gratuits.
Les majorations applicables dépendent de la prescription médicale :
- Indemnités de déplacement : IFD, IFI, IK
- Tarif nuit si prescrit
- Majoration de dimanches et jours fériés (injections, médicaments…)
- MIE pour les soins chez les enfants de moins de 7ans.
- MAU en cas d’acte unique.
Outils et dispositifs de suivi :
Les outils disponibles pour améliorer le suivi sont :
Les formations DPC pour infirmiers, et plus particulièrement les modules spécifiques pour améliorer la prise en charge : patients sous anticoagulants, insuffisance cardiaque Prado…
Le carnet de suivi de l’INR, obligatoire pour les patients sous AVK.
L’automesure INR : après formation de vos patients.
Les applications mobiles, et notamment celles qui permettent de programmer des alertes pour la prise des médicaments et le suivi INR.
Pour conclure :
Compte tenu du risque hémorragique que peut induire un traitement par anticoagulant, les patients qui bénéficient de se traitement doivent être rigoureusement suivis ou parfaitement éduqués pour pouvoir gérer ce traitement de manière autonome.
En tant qu’infirmier libéral, votre rôle est déterminant tant dans la surveillance clinique que dans l’éducation thérapeutique.
Il est tout aussi important dans la transmission des informations et la collaboration avec le médecin référent.
N’oubliez qu’en cas de problème dans l’administration des médicaments, non seulement la vie de votre patient est mise en danger, mais votre responsabilité est engagée.
Rassurez-vous, si vous voulez sécuriser votre pratique et actualiser vos connaissances sur la prise en charge des patients sous anticoagulant, vous pouvez vous inscrire à une de nos formations dédiées.
Et, si vous avez d’autres questions sur ce sujet sensible, n’hésitez pas à les poser.
Enfin, si cet article vous a plu, pensez à le partager à vos collègues et à vos patients.
Source :